Irrévérence - épisode 11 (TEXTE)
Le destin onusien d’un normalien rebelle. Conférence inaugurale.
Petit rappel et Avertissement : Tout comme l’ensemble du roman Irrévérence, le roman de l’ONU, cet épisode est une œuvre de fiction. En conséquence, toute ressemblance avec des personnes vivantes ou ayant vécu serait purement fortuite.
Pour le professeur Ruetcel, le temps de la réalisation de ses rêves et de ses aspirations semblait enfin arrivé.
Il lisait au micro les concluding remarks d’une conférence onusienne d’experts qui avait été convoquée à son instigation, laquelle avait été très courue et très suivie, parce qu’elle avait suscité bien des polémiques dès son annonce. En effet, ses travaux avaient porté sur la libéralisation des échanges commerciaux de produits alimentaires et agricoles dans le cadre de la mondialisation, une thématique particulièrement « chaude » – entre guillemets – à cette époque, au début des années 2000.
Après l’intervention finale de Ruetcel, une salve d’applaudissements avait salué les diverses innovations conceptuelles et méthodologiques qu’il avait soumises à débat – et que les conférenciers avaient affinées – ainsi que l’habilité avec laquelle il avait surmonté les controverses.
Et lorsqu’il était descendu de son pupitre, Ruetcel avait vu s’approcher de lui diverses personnes venues le complimenter, dont un inconnu que nous appellerons « l’homme de l’estrade », qui l’avait félicité pour sa brillante prestation. Il l’avait complimenté, également, pour l’ensemble de ses publications, qui, selon lui, resteraient comme autant de jalons scientifiques marquants, pour ne pas dire majeurs, dans les annales du débat sur le développement durable.
Longtemps, dans sa jeunesse, Ruetcel avait milité au sein de groupuscules politiques qui gravitaient à Paris autour de l’École normale de la rue d’Ulm, groupes anarchoïdes, ‘autonomes’, qui y discutaient âprement avec Toni Negri lors de ses passages à Paris. A l’époque, Ruetcel croyait que sa conscience politique l’obligeait à militer dans des comités de chômeurs de quartier, des collectifs de travailleurs immigrés sans-papiers, ou encore dans le mouvement antinucléaire ou des manifestations féministes.
Associé depuis les années 1970 à ce qui s’appelait le « mouvement » — entre guillemets —, qui avait été contemporain de l’émergence du ‘terrorisme’ de gauche de la Rote Armee Fraktion en Allemagne, puis des Brigate rosse en Italie, Ruetcel avait été tenté, à un moment, comme beaucoup d’autres de sa génération, par la clandestinité et la lutte armée. Il avait même balancé une paire de cocktails Molotov contre des CRS lors de la grande manif européenne contre le réacteur Superphénix, en 1977, à Creys-Malville, manif qui s’était soldée par la mort de l’un de ses camarades. Mais ces violentes rêveries révolutionnaires s’étaient soldées par une sorte de débâcle, une hémorragie militante des effectifs des groupuscules et la dissolution de diverses organisations effrayées par elles-mêmes et leurs tentations de lutte armée. Et ce fut la fin d’une impasse sanglante, marquée par l’enlèvement et la mort d’Aldo Moro, et de sévères répressions policières contre la gauche extra-parlementaire dans toute l’Europe.
Ruetcel avait alors senti qu’il était allé trop loin, au sein d’un mouvement qui lui-même dans ses outrances était allé trop loin. Il avait refusé de s’associer à la violence révolutionnaire, renoncé à l’usage des armes à feu, et il avait pris ses distances avec ses compagnons de lutte. Et pendant ce temps-là, la gauche parlementaire et bien-pensante, s’était engouffrée dans une social-démocratie bon teint et néolibérale, ce qui avait fini par donner le Parti démocratique italien et le Parti socialiste français, où divers militants trotskystes ou d’autres bords gauchistes avaient fait de l’entrisme, avant d’y faire carrière.
Déçu par la tournure des révolutions en Europe, Ruetcel s’était rabattu sur le tiers-monde. C’était de là, de la périphérie de l’occident capitaliste, selon les théories de Samir Amin, que surgirait le dépassement historique à venir. C’était là que divers mouvements révolutionnaires accumulaient des victoires – à la différence de ce qui se passait en Europe. Et c’était là, sur les traces de Ho Chi Min, du Che, de Nkrumah, de Frantz Fanon et de tant d’autres, que Ruetcel croyait qu’il pourrait se rendre utile, tout en goûtant aux joies de la révolution en marche, et aux plaisirs du socialisme réel. Au bout de quelques années d’appui à de tels processus, au Moyen-Orient et en Amérique latine, ayant perdu un certain nombre de ses illusions, il était revenu chez lui où il avait repris sa carrière universitaire française de normalien scientifique ordinaire.
Ruetcel était resté, cependant, un anticapitaliste convaincu, préoccupé par les accélérations de la mondialisation. Et il mobilisait désormais toutes ses capacités et ses énergies à l’étude et à la documentation des effets de la mondialisation dans le domaine environnemental et agricole.
L’« homme de l’estrade » qui s’était approché de lui à la fin de sa conférence était loin de suspecter, le passé révolutionnaire de Ruetcel, ni ses intentions de sabotage à l’égard des négociations de l’Organisation mondiale du commerce. Il se montrait enthousiaste. « Vos travaux, professeur Ruetcel, sont visionnaires, séminaux ! Pionniers ! Précurseurs ! Tout cela est frontier, mon cher professeur, frontier, oui ! comme disent nos amis américains ! Oui, elle fera date, cette conférence, et ils feront date, vos travaux, cher professeur Ruetcel ! Car vous placez – enfin ! – l’environnement et les ressources naturelles, les forêts, la biodiversité et l’agriculture à leurs justes places, au centre de la prospérité et de la viabilité du monde futur ! À mon avis, à l’ère post-industrielle et post-moderne qui est la nôtre, vous ouvrez la voie à des travaux concrets et pratiques – enfin ! – sur le biopouvoir et la biopolitique, fournissant une passerelle pour que l’action des organisations internationales soit informée par les vues de Foucault et d’Agamben ! »
« Oui ! », poursuivait l’homme. « Il constitue une fondation historique, votre projet ! Une innovation radicale ! Un véritable espoir pour les futures approches et les futurs Agendas de la communauté internationale !».
Cet « homme de l’estrade » entrevoyait des lumières, enfin ! pour la gouvernance des ressources naturelles et pour le devenir socio-économique des sociétés humaines. Presque en extase, il ne savait comment remercier le professeur Ruetcel pour ses idées et ses travaux, si multidisciplinaires et si amples, qui auraient tant de conséquences. Ils ouvraient la voie pour mille applications pratiques dans les programmes onusiens concernant les émigrés climatiques (un concept signé Ruetcel), les paiements publics pour des services environnementaux (concept cerné lui aussi par Ruetcel), la prévention des épidémies, et toutes les politiques publiques ayant trait à la biodiversité, à la faim dans le monde et à l’extrême pauvreté !
Ces thèmes recevraient – enfin ! – de l’avis de l’homme de l’estrade – l’attention qu’ils méritaient. Et ils seraient traités – enfin ! – avec des approches moins absconses, moins ridicules et moins éculées ! Et l’on prendrait conscience, oui, vraiment – enfin ! – de l’ampleur de toute une myriade d’externalités ignorées ou sous-évaluées, négligées et non prises en compte dans les choix de politique publique ! Grâce aux recherches du bon professeur Ruetcel, de très nombreux services non-marchands et biens publics liés à l’environnement et à l’agriculture pourraient enfin être mis en lumière, explicités, compris et mesurés. Et toutes ces externalités pourraient – enfin ! – être soumises à l’attention des décideurs de politiques et prises par eux, sérieusement, en considération, comme autant d’évidences incontournables.
Les fameuses Social accounting matrices des anglosaxons – en d’autres termes la comptabilité publique – seraient enfin capables de devenir, graduellement, écologiques, « verdies » ! C’est-à dire que le portrait général chiffré de l’économie prendrait enfin en compte les biens environnementaux !
L’homme de l’estrade croyait rêver. Il ne cessait de regarder, admiratif, et comme s’il s’agissait d’un véritable prodige, d’une sorte d’invraisemblable et de très improbable incarnation d’une pensée véritablement universelle, notre héros du jour, le brave professeur Ruetcel, lequel n’en demandait pas tant, et s’en trouvait à vrai dire assez… embarrassé.
« Comment de telles idées ont-elles pu germer dans votre esprit, cher professeur Ruetcel ? » L’homme de l’estrade poursuivait son apologie exaltée, fixant du regard un troisième œil hypothétique et miraculeux au centre du front de Ruetcel. « Et grâce au verdissement de nos Social accounting matrices », s’exclamait-t-il, presque en transe, « nos modèles macroéconomiques et nos simulations de politiques prendront enfin en compte la nature ! » criait-il les yeux exorbités. « Comment avez-vous pu concevoir cela ? Est-ce que votre formation de normalien y est pour quelque chose ? On dit tant et tant de merveilles sur l’École normale … »
L’homme de l’estrade avait sans doute lu un papier de la revue Nature qui avait quelques semaines plus tôt fait l’éloge de la recherche française, et de de « l’esprit normalien », et de l’« identité normalienne », en les illustrant par quelques interviews de normaliens.
Cet article avait parlé des concours mais aussi et surtout du sens de l’intérêt général, de la transmission et de l’engagement désintéressé qui caractérisaient selon lui « l’esprit et l’identité normaliens ». Les chercheurs interviewés – sans corporatisme, ils tenaient à le dire ! – se sentaient unis par cinq ou six caractéristiques fondamentales.
Premièrement, leur rapport au monde se distinguait par une grande ouverture d’esprit, et des normes très exigeantes d’explication. Ceci les plaçait de facto dans une posture existentielle de recherche. Deuxièmement, ils étaient tous très intelligents. Pendant leurs classes préparatoires, avant leurs concours d’entrée, on leur répétait sans cesse : « Vous êtes nuls ! ». Mais une fois qu’ils avaient réussi les concours et intégré Normale, on leur disait : « Si vous n’avez pas compris le cours, c’est le prof qui est nul !».
Bref, selon l’article de la revue Nature, le normalien – ou la normalienne – avait une capacité hors classe à apprendre, et à résoudre des problèmes. Ils étaient sûrs d’eux-mêmes, ils avaient une confiance sereine dans leur capacité à appréhender les problèmes, quels qu’ils soient.
Troisièmement, selon l’auteur du papier de Nature, les normaliens avaient une sensibilité particulière à l’égard du bien commun. Quatrièmement, ils avaient un sentiment de responsabilité sociale fort, ils se sentaient investi d’un rôle, et pensaient que les attentes de la société à leur égard étaient justifiées. Cinquièmement, tout ceci constituait une culture dite, entre guillemets, « culture normalienne » qui n’avait pas d’équivalent véritable ailleurs dans le monde. Le recrutement de ces talents s’effectuait très jeune, à 19 ou 20 ans, à un âge où les potentiels étaient remarquables, et ceci constituait une spécificité absente à Harvard ou à Oxford. Le résultat, c’était que les Écoles normales avaient le plus grand nombre d’alumni lauréats de prix Nobel par tête d’élève – un ratio qui les plaçait loin devant toutes les autres universités et structures de recherche du monde.
Le papier de la revue Nature soulignait que de telles caractéristiques investissaient chaque élève normalien d’une responsabilité à vie, qui durait toute sa vie professionnelle durant et au-delà. Il était doté, très jeune, d’outils extraordinaires pour l’innovation, et il se sentait attaché à ce rôle sur le long terme.
En particulier, signalait Nature, le normalien ou la normalienne avait a une habileté unique pour traiter des sujets complexes, et pour aborder les questions transversales, avec l’interdisciplinarité comme socle systématique. Ceci lui donnait aussi une grande force innovatrice, et une très bonne capacité d’interaction avec toutes sortes de métiers et de disciplines. Ceci le dotait aussi d’une grande force de proposition dans le cadre de projets collectifs. Cette « culture normalienne », très originale, faisait que la société ne savait pas toujours très bien que faire de ces normaliens, ces sortes d’hurluberlus – car ils étaient un peu des OVNI, ils faisaient un peu peur, ils avaient des capacités et des réactions « non-normales », et ceci faisait que, souvent, les gens ne savaient pas comment les appréhender.
Parmi leurs caractéristiques dérangeantes, et selon les interviewés par la revue Nature, les normaliens n’avaient que peu, ou bien encore que très peu d’ego. Ils étaient motivés avant tout par leur curiosité, et ce n’est donc pas leur égo qui déterminait leur posture. Ceci très souvent n’était pas bien perçu ni compris par leur entourage. Mais cette particularité – un ego le plus souvent atrophié – était réputée avoir beaucoup d’utilités – des utilités sociales, intellectuelles, scientifiques et artistiques…
Le normalien, poursuivait Nature, n’était pas perçu comme défendant un intérêt particulier, le sien par exemple, mais comme défendant une cause. Sa parole, en conséquence, était plus forte. Le normalien est écouté. Qui va lui refuser de l’écouter et de lui parler au téléphone cinq minutes ?
Le normalien était donc en bonne position pour faire du conseil en matière de politiques publiques. L’un des normaliens interviewés de la revue Nature disait en conclusion : « Notre identité est très liée à notre savoir-être. Notre posture n’est pas fondée sur la promotion de notre ego, mais sur notre aptitude à avoir une vision large des problèmes, et sur notre intérêt à les résoudre. »
Le brave le professeur Ruetcel, qui était issu d’un tel corps d’élite, et qui avait une telle posture, se demandait ce que l’homme de l’estrade avait bien pu avoir fumé, ou bien sniffé, avant de s’approcher de lui. Son enthousiasme naïf et son admiration disproportionnée commençait à l’incommoder et à l’inquiéter. Ce type lui était peut-être envoyé, à lui Ruetcel, par des gens qui ne lui voulaient pas que du bien ?
Pour calmer les ardeurs de ce gaillard, Ruetcel lui rappela que les méthodes d’estimation de la valeur des biens environnementaux – et en particulier les enquêtes sur les « disponibilités à payer » des consommateurs pour les biens et services environnementaux – faisaient l’objet de controverses très âpres. En conséquence, le verdissement, entre guillemets, c’est-à-dire le greening des Social accounting matrices n’était pas pour demain ! Mais l’homme de l’estrade balaya d’un geste de la main cet argument. Pour lui, les politiques publiques auraient désormais un peu moins de probabilités d’être aveugles et de se tromper dramatiquement en matière d’écologie !
Et l’homme de l’estrade renchérissait en disant que les recherches auxquelles Ruetcel s’était attelé jetaient les bases d’une théorie qui bouleverserait non seulement la pensée économique, mais l’ensemble des sciences sociales, y compris les sciences politiques. En effet, selon lui, ces travaux allaient bien au-delà de ceux d’Elinor Ostrom, la fameuse première femme prix Nobel d’économie, parce qu’en y intégrant et en y dépassant les innovations conceptuelles de Foucault et d’Agamben en matière de biopouvoir et de biopolitique, le professeur Ruetcel opérait un véritable chambardement de l’histoire de la pensée économique et de la philosophie politique – une véritable révolution copernicienne !
L’homme de l’estrade avait bien compris que Ruetcel se voulait pratique et concret, et qu’il avait une vision radicale des problèmes sociaux et politiques liés à la faim dans le monde. Il avait noté les paroles prononcées par le professeur – et il tenait à les répéter : « La société toute entière, les organisations internationales et les gouvernements constituent le conseil d’administration d’un vaste camp d’extermination, d’un vaste et camp de la mort. On n’y compte pas moins de trente mille morts de faim par jour. Un mort par seconde. »
Aux yeux de l’homme de l’estrade venu le complimenter, le professeur Ruetcel méritait un prix pour de telles paroles. « Professeur, vos recherches couvrent les deux tiers du paysannat et des affamés de la planète, et les trois quarts des terres cultivées : qui peut contester vos thèses ? », demanda-t-il. « Vous avez déjà le prix Leontief pour l’avancement des limites de la pensée économique », poursuivit-il. « Avez-vous songé au Nobel, professeur ? Il serait tout indiqué pour vous. Car grâce à vous, avec ce nouveau millénaire qui commence, la photosynthèse, le climat et le carbone deviennent les nouveaux moteurs de l’économie, et l’objet principal du biopouvoir et de la biopolitique ! Avec vos thèses néo-physiocratiques, vous jetez tout un éclairage nouveau sur toutes nos disciplines de sciences sociales ! Mais entre nous, cher professeur, jusqu’où iront vos recherches, que voulez-vous obtenir d’elles ? Jusqu’où vous portera votre ambition ? Quelles sont vos intentions ? Si je peux me permettre cette indiscrétion, bien entendu… Pardonnez-moi si je vous importune… Ce que vous faites-là est mémorable, et restera dans l’histoire de l’humanité. »
Embarrassé, Ruetcel avait baissé les yeux. Cet homme l’avait couvert de flagorneries. L’homme de l’estrade lui avait dit, là : « Vous avez entre les mains de quoi déboulonner l’orthodoxie de la pensée économique des organisations internationales, y compris la Banque Mondiale et Fonds Monétaire International ».
Qui pouvait-il bien être, cet homme de l’estrade ? Il n’avait malheureusement plus une seule carte de visite, s’en excusait. Il affirma être chercheur à Stanford, fit du name dropping, lâchant quelques noms d’illustres chercheurs avec lesquels il prétendait collaborer.
Il avait saisi bien des choses des travaux de Ruetcel, et il en maîtrisait à peu près les concepts. Intrigué par ce flatteur éhonté, par cet illuminé qui était peut-être aussi payé par ses adversaires, Ruetcel essaya de se ressaisir en se remémorant les questions qu’il lui avait adressées.
Ce type lui demandait quel était son ‘plan de carrière’, quelles étaient ses intentions, et jusqu’où il comptait aller dans ses recherches et ses plaidoyers de politiques publiques, et dans le renouvellement des recherches scientifiques internationales. Il avait demandé cela probablement pour mieux lui picorer la cervelle, le faire parler, et lui tirer les vers du nez ? Lui voler une ou deux idées ?
Ruetcel était resté silencieux, tandis que mille pensées traversaient son esprit. Il avait passé en revue ce que lui avait débité cet homme, et s’était demandé : « Suis-je ambitieux, moi, comme le suggère ce type ? »
Non, il ne l’était pas ‒ plus précisément : pas pour lui-même. Il n’avait aucun appétit pour la gloire ou le pouvoir. Pour certaines idées, oui, il était ambitieux. Parce qu’il les jugeait nécessaires, indispensables. « Est-ce que je remets en cause cette Agence ? » s’était-il encore demandé. Oui, au fond, car il aurait bien aimé qu’elle travaille avec des méthodes et sur des bases différentes. Il était complètement à contre-courant, il le savait. Et il s’était fait une belle brochette d’ennemis, il le savait. « Ai-je un plan de carrière et un agenda secret, comme le suggère ce type ? » Non. Il aspirait simplement à susciter un vrai débat, sur des bases scientifiques et philosophiques nouvelles, et qui soient aussi rigoureuses que possible.
Les agences onusiennes étaient remplies d’économistes fermement convaincus que les marchés « fonctionnaient », et qu’ils « fonctionnaient » bien, et qu’ils étaient la clé pour résoudre les inégalités sociales et toutes les crises environnementales et économiques. Pour eux, le marché était l’outil à mettre en œuvre pour éradiquer la faim et l’indigence qui affectaient le sixième de l’humanité.
Ils savaient qu’ils tenaient entre leurs mains les manettes du véritable pouvoir politique de l’Onu. Ils lui dictaient sa ligne institutionnelle. Ils la tenaient strictement alignée sur les principes du FMI, de la Banque mondiale et de Washington. Ils se sentaient les chiens de garde de cette ligne politique, ils en étaient fiers, et ils se comportaient comme tels, convaincus, naïvement, que les ruissellements de la croissance mettraient fin à la pauvreté extrême et à la faim dans le monde.
Ils se permettaient de traiter avec morgue les spécialistes des autres disciplines scientifiques, et ils arboraient une indifférence souveraine et un mépris hautain à l’égard des départements et des agences de l’Onu qui représentaient son ‘bras humanitaire’, Unicef, Pam, etc. Leur arrogance, leur suffisance et leur ignorance étaient insupportables à Ruetcel. Ces gens-là n’étaient, à ses yeux, et pour la plupart, qu’un ramassis de piètres et médiocres conformistes, dangereux, pitoyables et incultes, souvent d’une ignorance et d’une indifférence criminelles.
Et contre leurs vues, le professeur Ruetcel avait obtenu de cette conférence d’experts, qui se concluait, tout ce qu’il en attendait. Elle avait validé ses hypothèses. Approuvé au-delà de ses attentes le bien-fondé de son approche. Et ses participants lui avaient suggéré des ajustements et de nombreux partenariats utiles : il en était très satisfait.
Mais le professeur pendant toute la conférence n’avait presque pas ouvert le bec – hormis le strict minimum seyant à son rôle. Car le fond de sa pensée, qu’il se gardait bien de partager pour ne pas être aussitôt insulté et ostracisé comme marxiste et crypto communiste, était que la Banque mondiale et le Fond Monétaire International étaient coupables de crimes contre l’humanité.
Le professeur Ruetcel se savait menacé d’avoir de telles pensées, mais il savait bien, aussi, que ses recherches, en vérité, ressemblaient à une déclaration de guerre intellectuelle contre les théories et les vues dominantes, contre le néo-libéralisme et le capitalisme mainstream qui présidaient aux destinées de la communauté internationale.
Et Ruetcel se demandait donc ce qu’il pourrait bien répondre à cet homme, là, debout devant lui, cet « homme de l’estrade » qui semblait avoir bien compris ses pensées, mais dont il ne savait de quel bord il était : un authentique supporter de ses vues à lui, Ruetcel, ou bien un espion, un agent de ses ennemis, un « indic » habile et pervers ?
Le professeur Ruetcel, sans avoir peur de trop s’exposer, décida d’être franc et de dire à cet homme de l’estrade le fond de sa pensée. Et il lâcha donc finalement, au grand étonnement de l’homme de l’estrade : « Je vous remercie pour vos belles paroles et pour vos questions. Je souhaite seulement que cette Agence traite convenablement du sujet dont elle est sensée s’occuper. C’est-à-dire qu’elle s’occupe, vraiment, de l’artificialisation des milieux naturels et des écosystèmes au service des systèmes alimentaires préférentiellement utiles aux humains. Et qu’elle s’occupe, véritablement, et en toute rigueur de nos systèmes alimentaires, en analysant de manière critique, et en premier lieu, les colossales puissances financières de ses principaux acteurs. Si cette Agence onusienne ne fait pas ce travail, si elle ne documente honnêtement et de manière impartiale et critique les intérêts ici en jeu – ainsi que leurs choix techniques et surtout politiques – alors, à mon avis, c’est très simple : cette Agence de l’Onu n’a plus de raison d’être. Elle devrait fermer ses portes. Et le directeur devrait démissionner, et mettre la clé sous le paillasson. Ou alors, les pays-membres de l’Agence devraient lancer contre lui une procédure d’impeachment. Ou bien encore la dissoudre, la supprimer, cette Agence. Car sinon, elle restera ce qu’elle est aujourd’hui : une usine à gaz, et une vaste bureaucratie, parasite et hypocrite. Qui maintient l’horreur du statu quo. Ne croyez-vous pas ? Non ? Je me trompe ? Vous n’êtes pas d’accord avec moi ? Je vous choque ? Vous me trouvez cynique ? Ce genre de choses peut-il se discuter ici ? »
Ce disant, et s’étant soulagé par cet élan de franchise provocante, le professeur Ruetcel ramassait ses papiers et ses affaires et les rangeait dans son porte-document, comme pour signifier à son interlocuteur, l’homme de l’estrade, qu’il désirait en rester là de leur entretien. L’homme le dévisageait, stupéfait, complètement incrédule, pâle et effrayé, comme s’il avait affaire à une sorte de prodige, à un mort-vivant, à un véritable zombie ou encore à un dangereux paranoïaque.
Arrivé le lendemain dans son bureau à huit heures, Ruetcel accrocha son paletot au porte-manteau. Il sortit de son vieux cartable de cuir les dossiers qu’il avait épluchés et annotés pendant son insomnie.
Il alluma distraitement son PC en appuyant sur start . Ses sourcils broussailleux à l’extrême — mythiquement broussailleux — se froncèrent soudain. Ils se rehaussèrent aussitôt, étonnés. Puis ils se froncèrent de nouveau, furieusement. L’écran que fixaient ses yeux était vide, uniformément bleu et vide, luminescent, mais sans aucune manifestation de fonctionnement. Il tapota rageusement sur quelques touches du clavier mais comprit vite que sa bécane ne répondait à aucune commande. Il éteint et ralluma l’engin plusieurs fois. Il défit et refit rageusement les raccords électriques de sa machine et leurs divers embrouillaminis. Zéro résultat. C’était la panne. La panne.
Il jeta un coup d’œil rapide par sa baie vitrée sur le Colisée. Le ciel était dans un piteux état, et la sale météo du jour, annoncée à la radio, semblait avoir raison. Une belle sale foutue journée dégueulasse s’annonçait. Il pesta abondamment, en faisant appel à ses jurons favoris et à divers blasphèmes que le capitaine Haddock, paix à son âme, lui envia depuis son paradis.
Le technicien du service informatique, le IT officer appelé à la rescousse, ne frappa à sa porte qu’une demi-heure plus tard. Il identifia vite le problème : disque dur. Le cadenas qui protégeait ce disque au dos de l’appareil avait été forcé. Et le disque dur avait disparu. Volé.
À suivre…
Merci d'avoir lu cet épisode d’Irrévérence - le roman de l’ONU. Ce Post est public alors n'hésitez pas à le partager.




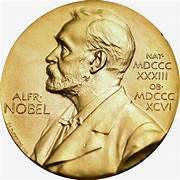
Vivement la suite! Bonne année, Ruetcel !